Vues de la fenêtre (depuis 2008), extraits
Vues de la fenêtre (depuis 2008), extraits
Vues de la fenêtre, depuis 2008
La vue de la fenêtre peut être considérée comme le paradigme de toute image dans la culture occidentale.
C’est également le modèle parfait de la perspective centrale, l’œil devant rester immobile.
L’une des premières photographies, celle de Nicéphore Niepce en 1827, a été réalisée d’une fenêtre : c’est le Point de vue de la fenêtre du Gras à Saint-Loup-de-Varennes, près de Chalon-sur-Saône.
Reproduction en négatif de la plaque originale conservée au Harry Ransom Center, université du Texas, Austin (USA).
Tirage retouché par l’historien Helmut Gernsheim afin de rendre l’image plus lisible.
À travers ce cadre qu’est la fenêtre, la vue de l’extérieur (l’autre) atteint sans dommage l’intérieur (soi-même). Cette vision, rassurante et partielle, reste protégée par les murs de la maison. La concession de l’ouverture est nécessaire — bien que l’on puisse se contenter d’un petit trou (sténopé) —, le point de vue et la perspective l’exigent.
Comme à travers la fenêtre du train, il s’agit d’une vue qui s’impose et en impose, ne donnant pas ou peu le choix du cadrage, au contraire de la marche où tout peut devenir image, où le braconnage est ouvert.
Ici, malgré quelques mouvements ou déplacements possibles, l’immobilité domine. Bruits, odeurs et autres perceptions sont relégués à l’arrière-plan. Une contemplation peut commencer, qu’importe ce que l’on a devant les yeux, et qu’importe où cela va nous emmener.
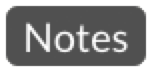
(à suivre)
© Jean pierre Morcrette 1966-
01/01/2026